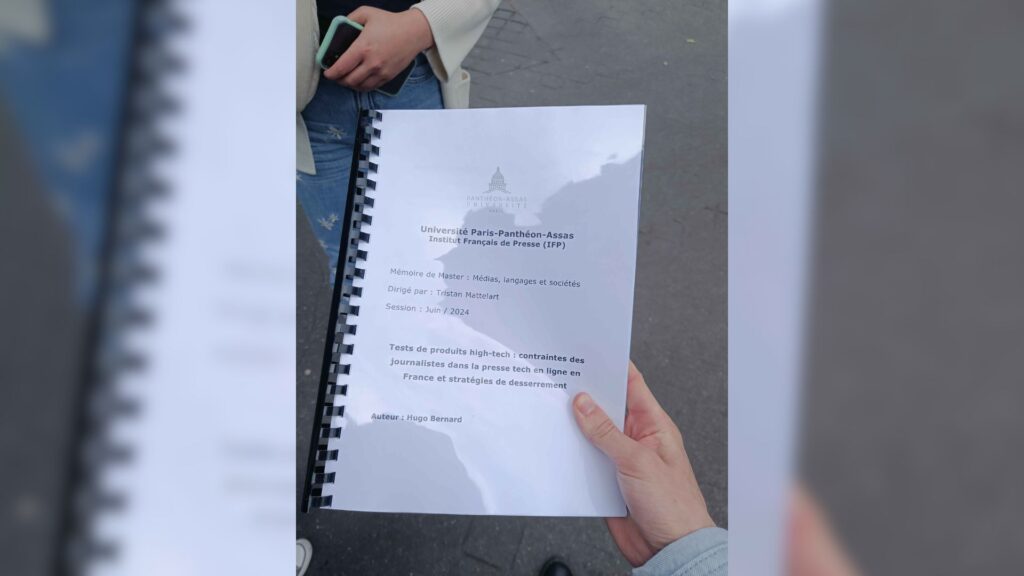Fiche de lecture et résumé détaillé de l’article Mise en œuvre de la méthodologie de l’observation participante dans le cadre d’un mémoire de M2 par Christine Philip et Pierre De Battista.
À lire également : La rave-party au miroir d’une sociologie du sujet, par Ingrid Voléry
Résumé de Mise en œuvre de la méthodologie de l’observation participante dans le cadre d’un mémoire de M2
« Cet article à deux voix présente un exemple de mise en œuvre de la méthodologie de l’observation participante, dans le cadre d’une enquête de terrain. Il s’agit de l’observation d’une réunion par un directeur de Sessad, engagé lui-même dans cette équipe de suivi de scolarisation, dont il analyse le fonctionnement en prenant un recul critique sur sa pratique professionnelle. Cette méthode, assez peu utilisée dans les recherches en sciences sociales, permet pourtant d’être au plus près des réalités pour les comprendre en profondeur. Analyser des situations concrètes aide à apprécier des pratiques professionnelles de façon beaucoup plus directe qu’il n’est possible de le faire en sollicitant le point de vue des acteurs dans des entretiens. Cette approche constitue ainsi un complément d’enquête qui mérite d’être exploré. »
À lire également : L’observation participante : une méthode pratique selon Sylvie Tétreault
L’observation participante et les difficultés de sa mise en œuvre
Historique et définition de cette approche
Comme beaucoup de sociologues le font remarquer, la méthode de l’observation participante n’est pas très utilisée. Elle a même plusieurs noms, comme le fait remarquer l’enseignante Christine Philip : « observation directe, observation participante ou observation en situation… » Alors qu’ils considèrent que c’est une méthode « très riche, qui permet une analyse qualitative en profondeur des réalités institutionnelles. » C’est le cas tant pour des mémoires de master que pour des enseignants. Si les entretiens semi-directifs permettent de recueillir des points de vue des acteurs, ils ne permettent pas d’apprécier les pratiques réelles, alors qu’il y a un écart entre « dire » et « faire ».
Cette méthodologie a principalement été utilisée en anthropologie, mais a été adoptée par la sociologie. Cette approche privilégie « non la mise à distance de l’objet, mais, au contraire, l’imprégnation de l’observateur par cet objet. » Une approche dans laquelle la « participation » du chercheur est essentiel, puisque « son implication est au centre du processus d’observation. » L’observation participante permet de « pénétrer dans la subjectivité des observés » en vivant une situation en même temps. Cela implique d’être physiquement présent, de plusieurs manières possibles, comme l’écrivait Gold (R. Gold, “Roles in Sociological Field Observation”, 1958, Social Forces, 36, p. 217-223.) :
- Un « participant complet » : le chercheur n’appartient pas à la communauté qu’il observe et s’immerge dans la situation, tout en étant incognito. Philip note qu’ainsi, « il ne pourra pas lui être reproché de modifier la situation par sa présence, puisque celle-ci est ignorée des participants. » ;
- Un « participant observateur » : le chercheur fait partie de la communauté qu’il observe, « mais ne cache pas son désir d’observer ce qui s’y passe. » Cela « amoindrit l’effet perturbateur qu’il peut avoir sur le groupe » ; son statut d’observateur est connu ;
- Un « observateur participant » : le chercheur fait partie du groupe, mais pas de la communauté qu’il observe, en est extérieur. Il doit alors se rapprocher des personnes pour mieux les comprendre : « il est observateur avant d’être participant » et son statut est connu ;
- Un « observateur complet » : le chercheur ne prend pas part à l’action, est en retrait et est reconnu en observateur.
Pour Philip, « aucune posture ne doit être considérée comme meilleure que l’autre, dans la mesure où l’avantage du participant c’est d’être vraiment à l’intérieur, sa principale difficulté étant de se distancier et de rendre le familier étrange… alors que l’avantage de l’autre posture est d’être libre d’aller et venir, mais l’effort d’implication doit être alors plus important pour arriver à saisir les processus de l’intérieur. »
Que suppose cette approche comme démarche, mais aussi comme qualités à mettre en œuvre ?
L’enseignante rappelle les quatre tâches incontournables de l’observation participante, selon Martineau (R. Gold, “Roles in Sociological Field Observation”, 1958, Social Forces, 36, p. 217-223. Cité par Stéphane Martineau, dans son article sur l’observation en situation (voir référence suivante).) :
- Le chercheur doit s’adapter au milieu observé : cela « demande une certaine souplesse d’esprit, sauf si l’observateur fait partie du milieu. » ;
- Il faut observer le déroulement des événements, ce qui demande de s’étonner, « donc à se dé-familiariser lorsque l’on est trop proche », savoir écouter ;
- Garder une trace des observations : enregistrer, prendre des notes, faire des enregistrements audio/vidéo ;
- Rendre compte par écrit « de ce qui a été observé, afin d’en proposer une analyse et une interprétation. »
Philip aborde aussi l’utilisation d’une grille d’observation. Selon elle, « l’avantage est que la grille va cibler des éléments de la situation à observer, ce qui permet de ne pas se sentir noyé par la multiplicité des aspects à prendre en compte dans la situation. Mais son principal inconvénient est précisément de cibler l’observation sur certains aspects et de passer à côté d’autres aspects qui n’auront pas été prévus. » Pour Martineau d’ailleurs, « le chercheur rivé sur sa grille n’est plus ouvert à la nouveauté, à l’inattendu et à l’étrange, à l’inhabituel. Il y a, dans ce cas, danger de passer à côté d’évènements significatifs pour la compréhension fine de l’objet d’étude ».
Les objections faites à cette approche
Les détracteurs de l’observation participante considèrent que « par sa présence l’observateur perturbe ainsi la situation qu’il observe et qu’il fait intervenir sa propre subjectivité dans son analyse de la situation. » Cependant, peu importe la méthode qu’on utilise, il y aura forcément des biais.
Il y a aussi une difficulté avec cette méthode de recherche : « la capacité à donner du sens à ce que l’on observe ». Philip écrit qu’il faut observer, mais aussi « savoir questionner et enquêter et savoir donner sens à ce qu’on observe. » Par ailleurs, il est difficile d’être à la fois observateur et acteur. C’est là que les dispositifs d’enregistrement sont d’une grande aide.
La grille d’observation et l’observation participante sont nécessairement des méthodes subjectives : leur subjectivité est leur principal avantage et leur principal inconvénient.